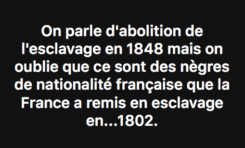En 1848, certains esclaves des colonies françaises ont reçu, en échange de leur liberté, un nom de famille injurieux que portent encore leurs descendants actuels. Des centaines de patronymes saugrenus ou dégradants donnés arbitrairement aux esclaves libérés et qu’il fallait enregistrer dans les registres d’Etat civil.
Il est des patronymes qui sont durs à porter. Nulle part ailleurs que dans les Antilles et en Guyane françaises, si ce n’est dans d’autres anciennes colonies, il y en a autant et d’aussi insultants.
Dans ces régions, s’appeler M. Crétinoir, Trouabal ou Pasbeau, Mme Vulgaire, Macabre ou Gros-Désir n’est pas rare.
Philippe Chanson, aumônier à l’Université de Genève et membre du Laboratoire d’anthropologie prospective de l’Université catholique de Louvain, a consacré une recherche approfondie à ce sujet. Elle a abouti à la rédaction d’un ouvrage récemment paru, La Blessure du nom, dont les annexes regorgent de centaines de patronymes saugrenus ou dégradants donnés arbitrairement aux esclaves libérés en 1848 et qu’il fallait enregistrer dans les registres d’Etat civil.
Nombre de leurs descendants les portent encore aujourd’hui. Avec honte et résignation souvent. Avec douleur toujours.

FRERE SATAN
«Je me rends dans les Antilles françaises et en Guyane depuis très longtemps, raconte Philippe Chanson. J’y suis même resté sept ans d’affilée entre 1987 et 1994, car j’étais engagé en tant que théologien pour former des pasteurs à Cayenne. Depuis le début, j’ai été sensible aux blessures causées par l’esclavage. Je me suis orienté vers l’anthropologie et j’ai écrit plus de 50 articles à ce sujet.»
A l’arrachement de ces hommes et de ces femmes à leur terre, à la perte de leur langue, de leur histoire, à la péjoration de la couleur de leur peau et à l’interdiction de leur patronyme africain d’origine s’est ajouté, quelques siècles plus tard, l’im- position d’un nouveau nom par l’ancien maître blanc.
«Toutes ces blessures ont fait l’objet de recherches, admet Philippe Chanson, qui s’est notamment entretenu dans le cadre de ses travaux avec de grands intellectuels antillais comme Aimé Césaire, décédé en avril 2008, les écrivains Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant ou encore le romancier et directeur des Affaires culturelles de la Guadeloupe Ernest Pépin. Toutes sauf celle concernant le nom. Pourtant, cette ultime humiliation est flagrante et déploie ses effets jusqu’à nos jours.» Comment rester de marbre, en effet, lorsque le haut-parleur de l’Aéroport de Fort-de-France appelle M. Zonzon ou Mme Caracasse à se rendre immédiatement à la porte de départ? Ou lorsque le prêche du jour dans une paroisse de Guadeloupe est assuré par frère Satan? Ou encore lorsqu’un professeur doit apprécier le travail de l’élève Zéro en Guyane?
Le chercheur estime que la proportion de la population actuelle des Antilles et de la Guyane portant des noms «problématiques» se situe entre 5 et 10%. Quant aux 60 «pires patronymes» qu’il a sélectionnés (une liste qui comprend, en plus des noms déjà cités, Malcousu, Pancarte, Betacorne, Rosbif, Paindépice…), ils ont été donnés à 4716 personnes nées entre 1916 et 1990, selon les registres officiels, sans compter leurs parents, familles et descendants.
Le recensement réalisé par Philippe Chanson a été laborieux. Il a commencé par éplucher les annuaires de téléphone. Une mine de 350 000 noms à laquelle il a fallu appliquer une série de filtres. «J’ai notamment retranché les noms des anciennes familles coloniales et ceux d’immigrés africains venus après 1848, précise l’aumônier. Idem avec les descendants de travailleurs indiens, chinois, syriens, libanais et autres qui sont venus remplacer les esclaves après leur libération. Les Antilles et la Guyane abritent une quantité incroyable d’origines différentes.» Ultime outil pour faire le tri, et pas des moindres, le chercheur exploite sa profonde connaissance de ces régions et des gens qui les peuplent.
Entrer en contact avec les personnes affublées d’un patronyme problématique, en revanche, s’est avéré difficile. «Il est impossible d’aborder ce problème de front, souligne Philippe Chanson. Les Antillais et Guyanais entretiennent une culture de la suspicion, non seulement envers les Européens, mais aussi entre eux. Une caractéristique qui oblige à passer par la médiation. Je ne pourrai donc jamais parler de son nom àMme Coucoune(vagin en créole). Je suis obligé de passer par quelqu’un d’autre, un tiers non porteur d’un nom honteux.»
REPARER LE MAL
Il peut paraître curieux que les descendants d’esclaves n’aient jamais songé à changer de nom, comme la loi française les y autorise. Il faut dire que beaucoup ignorent la démarche, par ailleurs complexe, longue et coûteuse, ne lisent ni n’écrivent avec facilité ou encore craignent les arcanes de l’administration. Selon l’aumônier, le sentiment que c’est à la France qu’il revient de réparer le mal, est également très fort.
En attendant, les gens s’accommodent de leurs noms de famille saugrenus, ou trouvent des stratagèmes. Entre eux, ils s’appellent volontiers par un surnom qu’ils ont acquis dans leur jeunesse et qu’ils ont accepté. Beaucoup dissimulent leur patronyme. On ne trouve ainsi pas souvent de nom sur les portes et on ne l’entend presque jamais non plus au téléphone en décrochant. D’ailleurs, beaucoup d’individus se mettent sur liste rouge, non pas parce qu’ils sont célèbres, mais pour cacher leur nom. Et puis, sur un plan plus magico-religieux, la coutume venue d’Afrique de s’attribuer un nom secret– que personne ne connaîtra jamais – existe encore aux Antilles et en Guyane. «Il s’agit là d’une façon de se protéger des mauvais sorts envoyé par des malveillants qui montre bien l’importance que revêt un nom dans la culture créole», note Philippe Chanson.
FREIN SOCIAL
Il n’est pas exclu qu’un patronyme dégradant joue le rôle de frein social. Va-t-on engager pour le poste de caissière dans un supermarché Mme Bonnarien avec le risque que ce mot soit inscrit sur sa blouse? «Je ne peux répondre à cette question, admet Philippe Chanson. Il faudrait étudier ce problème spécifiquement.»
L’aumônier prêche toutefois en faveur d’une reconnaissance officielle du problème. L’Etat français devrait, selon lui, prendre acte de cette séquelle de l’esclavage et offrir à ceux qui en sont touchés la possibilité de changer de nom, gratuitement et facilement. Et pour ceux qui ne le voudraient pas (choisir un nouveau nom peut également s’avérer problématique), Philippe Chanson suggère la tenue d’une céré- monie à la fois civile et religieuse (après tout, l’Eglise a baptisé les enfants des colonies du- rant des siècles et était soudainement absente lors de l’attribution des noms de famille en 1848). Une cérémonie durant laquelle les per- sonnes pourraient, par un geste symbolique, écrire leur nom pour en prendre possession de plein gré.
Source : Campus N° 92 – Anton Vos
Des commis malintentionnés
l’histoire des patronymes injurieux n’est pas très documentée. «En 1848, au moment de l’abolition de l’esclavage, il fallait donner un nom de famille à 170 000 affranchis pour pouvoir les inscrire dans l’Etat civil et leur fournir un acte d’identité, explique Philippe Chanson, aumônier à l’Université de Genève. Pour le reste, il faut se borner à reconstituer la scène de la façon la plus probable qui soit. Une histoire-fiction que l’écrivain martiniquais Edouard Glissant a qualifiée de vision prophétique du passé.»
D’un côté, on trouve les anciens esclaves, presque tous analphabètes. Tous ne saisis- sent pas l’importance de la procédure et doivent craindre l’administration. De l’autre sont assis les commis de mairie, pas tous habités de bonnes intentions. Ils sont chargés d’enregistrer leur déposition. l’opération devait être bouclée en trois mois. Elle a duré près de dix ans.
si certains affranchis viennent avec un nom écrit par leur ancien maître sur un pa- pier, c’est souvent le commis lui-même qui doit en trouver un. Il n’a pas le droit d’utiliser des patronymes en usage en France métropolitaine. Il s’aide donc de listes (noms bibliques, géographiques, topographiques, de métiers, d’objets de la vie quotidienne, etc.). Parfois il cède à l’énervement et baptise Passavoir celui qui ne peut répondre à ses questions. On suspecte aussi certains de manifester leur mépris pour les anciens esclaves par un dernier abus de pouvoir.
«La Blessure du nom, une anthropologie d’une séquelle de l’esclavage aux Antilles-Guyane», par Philippe Chanson, Ed. Academia-Bruylant, collection Anthropologie prospective, Louvain-la-Neuve, 2008, 154 p.




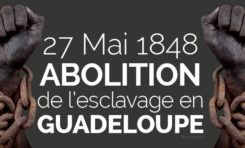



 : la République défigurée
: la République défigurée